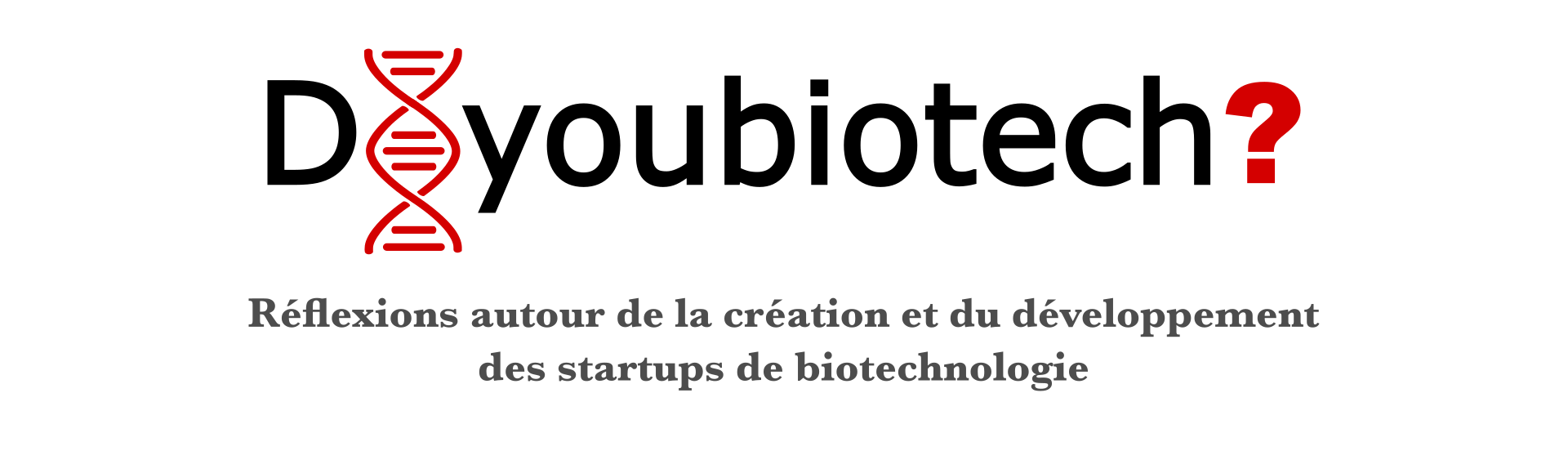Découvrez les responsabilités du Chief Executive Officer dans une startup de biotechnologie, ainsi que les parcours pour arriver à ce poste.
Voici le premier d’article d’une nouvelle série consacrée aux différents postes dans une startup de biotechnologie. Nous allons couvrir les principaux postes de directeurs (général, financier, scientifique, médical, des opérations, etc.) et les départements qu’ils dirigent (RH, financier, recherche, développement clinique, CMC, business development, etc.).
Bonne lecture !
Qui est le CEO
Le CEO (prononcez « si-i-o »), ou « Chief Executive Officer », c’est-à-dire le Directeur Général, peut être le fondateur (ou co-fondateur) de l’entreprise. Il est dans ce cas souvent un scientifique travaillant dans un laboratoire académique qui crée une entreprise sur la base d’une découverte scientifique réalisée dans le cadre de ses fonctions de chercheur.
Le CEO peut aussi arriver un peu plus tard après la création de l’entreprise, en remplacement du fondateur. En effet, il arrive régulièrement qu’un scientifique aguerri crée une startup sans quitter son emploi de chercheur (souvent de directeur de recherche, voire de laboratoire). Lorsque le développement de l’entreprise exige une présence à plein temps, c’est à ce moment qu’un CEO externe est recruté. Il s’agit alors d’un profil plus sénior (typiquement plus cinquantenaire que trentenaire), souvent de formation scientifique, avec une expérience validée, notamment pour lever des fonds auprès d’investisseurs.
Dans le rapport 2024 édité par « BIO » (Biotechnology Innovation Organization), on trouve l’information qu’en 2023, le CEO est dans 78% des cas un homme qui préside un comité exécutif composé de 60% d’hommes et qui rapporte à un conseil d’administration où 61% des membres sont des hommes. Dans le même temps, les entreprises de biotechnologie ayant répondu à l’enquête de BIO sont à 50% composées de femmes…
Le CEO sera donc à n’en pas douter de plus en plus souvent une femme, mais il reste encore un peu de chemin à parcourir avant d’arriver à la parité !
Que fait le CEO ?
Maintenant que nous avons défini le profil du CEO, voyons ses principales responsabilités :
- Représenter l’entreprise à l’extérieur
- Manager le personnel de l’entreprise
- Définir la stratégie de l’entreprise
Représenter l’entreprise à l’extérieur
Le CEO est l’incarnation de l’entreprise auprès des tiers.
D’un point de vue légal, tout d’abord, le Directeur Général, ou le Président, d’une entreprise est un « mandataire social ». Littéralement, il s’agit d’une personne à qui la société a délégué le pouvoir de la représenter auprès des tiers. C’est lui seul dont la signature peut engager l’entreprise, pour signer des commandes ou des contrats de licence, par exemple.
Lever des fonds :
En dehors de ces implications juridiques, une des premières missions du CEO est de convaincre des investisseurs que sa stratégie d’entreprise est la meilleure et que sa mise en œuvre leur permettra d’obtenir un avantageux retour sur investissement.
Faire le lien avec le grand public :
Le CEO est aussi celui qui s’adresse aux journalistes pour des interviews ou qui parle lors des salons professionnels, pour communiquer les ambitions de l’entreprise.
Business development / Partenariats :
Même s’il n’est pas toujours directement impliqué dans les négociations au quotidien, le CEO supervise et à le dernier mot lors des éventuelles discussions de partenariats avec d’autres entreprises biopharmaceutiques.
Manager le personnel de l’entreprise
Le CEO se situe au sommet de l’organigramme de l’entreprise. Tous les employés lui rapportent directement ou indirectement.
Typiquement, dès que l’entreprise aura un peu grossi, le CEO discutera principalement avec la « C-suite » (prononcer « si-suite »), c’est-à-dire les autres employés dont le titre commence par un « C » (pour Chief). On parle de postes « C-level », dont l’équivalent en français est simplement « directeurs ».
La C-Suite est donc l’équivalent du comité exécutif (« COMEX ») ou du comité de direction (« CODIR »). Dans cette instance, les directeurs des différentes activités de l’entreprise exposent l’avancée des projets dont ils ont la charge, et discutent des éventuels problèmes rencontrés.
Néanmoins, le CEO continue d’être responsable de la performance de l’ensemble des employés de l’entreprise. Il s’assurera avec la DRH (« directrice des ressources humaines ») qu’une politique adéquate est en place pour recruter (il a en général le dernier mot sur le choix des futurs employés), rémunérer et former le personnel. Il contrôlera la manière dont ses N-1 (la susnommée « C-Suite ») gèrent leurs équipes.
Il s’adressera aussi régulièrement à l’ensemble du personnel, lors de réunion générale (« town hall meeting » en anglais), pour communiquer sur l’avancée de l’entreprise ou les éventuels ajustements de la stratégie.

Définir la stratégie de l’entreprise
Cela correspond à identifier les buts à long terme et le type de chemin à suivre pour les atteindre.
Reprenons notre exemple de Future Therapeutics : le CEO pense que l’entreprise a le potentiel pour commercialiser ses propres médicaments. Le but de long terme sera donc d’avoir un puis plusieurs produits qui peuvent être vendus, de manière compétitive, par une petite entreprise fondée en France. Si l’entreprise a été fondée sur une technologie qui pourrait être appliquée dans plusieurs domaines thérapeutiques (plusieurs types de maladies), ce but de long terme va définir dans quel domaine se concentrer. Par exemple, on peut estimer qu’il est plus intelligent pour Future Therapeutics de se développer dans le secteur des maladies rares (maladies qui touchent seulement un petit nombre de patients) car les petites biotech peuvent pratiquement faire jeu égal avec les plus grosses. Ce ne serait pas le cas par exemple dans le domaine du diabète où les « big pharmas » ont un avantage d’échelle considérable.
La stratégie de long terme guide aussi le choix des éventuels partenariats. Dans notre exemple, on privilégiera ceux qui permettent à Future Therapeutics d’obtenir des financements tout en gardant la main sur le développement clinique puis la commercialisation dans au moins une aire géographique.
Par exemple : on signera le partenariat avec Sanofi qui proposerait de se charger de la commercialisation aux Etats-Unis mais laisserait Future Therapeutics être en charge des ventes en Europe. A l’inverse, on ne signera pas celui avec Astrazeneca qui imposerait de se contenter de recevoir d’éventuelles royalties sans avoir de pouvoir de décision sur le développement et la commercialisation dans le monde entier.
Ce but de long terme va aussi influencer le recrutement car on va privilégier les personnes qui auront l’expérience adéquate dans les domaines concernés (réglementaire, production, marketing). Idem pour le choix des investisseurs que l’on va courtiser préférentiellement. Certains ont l’habitude, et l’ambition, d’accompagner leurs investissements jusqu’à la ligne d’arrivée, d’autres n’envisagent pas de rester au-delà du démarrage des essais cliniques.
En résumé, pour notre exemple :
- Stratégie de Future Therapeutics = commercialiser ses médicaments
- Implications :
- Focus sur les maladies rares
- Choix de partenaires permettant de réaliser un co-développement
- Recrutement d’employés avec une expérience compatible avec le lancement commercial de médicament
- Choix d’investisseurs ayant la capacité d’accompagner l’entreprise jusqu’à la mise sur le marché d’un médicament
La stratégie présentée dans les paragraphes précédents n’est qu’une des nombreuses stratégies possibles. Future Therapeutics pourrait aussi viser un rachat le plus tôt possible et donc favoriser un domaine thérapeutique plus adapté, comme l’oncologie, tout en n’embauchant que le strict minimum d’employés nécessaires à court terme. L’entreprise pourrait au contraire choisir d’explorer tous les domaines d’applications possibles mais se contenter de vendre des licences d’utilisation de sa technologie, dès qu’une preuve de concept est obtenue. Etc.
Les différents profils de CEO
Le choix de la stratégie va dépendre de l’appétence personnel du CEO pour tel ou tel profil d’entreprise, de son analyse de la stratégie qui donnera les meilleurs chances de réussites à l’entreprise, en fonction des ressources financières, et en termes de compétence disponibles.
Évidemment, le CEO ne prend pas ses décisions dans le vide. Il le fait sur la base des expertises apportées par ses collaborateurs et sur la base des retours donnés par des investisseurs potentiels. Si l’entreprise a déjà réalisé un tour d’investissement, il doit aussi convaincre son conseil d’administration, ou Board of Directors (qui représente les actionnaires de l’entreprise), que sa stratégie est la bonne. Faute de quoi il ne sera pas autorisé à l’appliquer
Avec un tel périmètre de responsabilités, les CEOs tendent à avoir un domaine de prédilection qui fait qu’on a rarement des profils parfaitement équilibrés. Certains seront des CEO/CFO (CFO = Chief Financial Officer = Directeur Financier), très versés dans la stratégie financière mais se reposant plus sur les apports des autres « C-levels » (les membres du comité de direction) pour la partie management ou la définition de la stratégie scientifique. Certains seront des CEO/CBO (CBO = Chief Business Officer = Directeur de la Stratégie (traduction à prendre avec prudence)), directement impliqués dans les discussions de partenariats industriels et très investis dans la gestion au jour le jour des discussions avec les investisseurs potentiels. D’autres encore seront d’une influence majeure sur la stratégie scientifique ou clinique et seront plus des CEO/CSO, etc. Toutes les combinaisons et toutes les nuances sont possibles !
Conclusion
Le CEO est un des postes les mieux rémunérés de l’entreprise (il n’est pas rare toutefois que le directeur médical ait un plus gros salaire que le CEO). Son salaire brut est compris entre 100 et 350 000€, auquel il faut ajouter des primes sur objectifs qui peuvent être substantielles (une prime de 100% du salaire est tout à fait envisageable) ainsi que des BSPCE (bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise) ou d’autres types de stock-options.
En contrepartie, c’est sur lui que reposent beaucoup de choses et la pression ressentie peut-être très élevée, en particulier si les choses ne se passent pas comme prévu. Il est, de plus, assez seul face à de nombreux enjeux. Il ne peut, en effet, pas se confier sur tous les sujets avec ses N-1, ni avec son conseil d’administration qui a le pouvoir de le révoquer à tout moment. Enfin, bien qu’il soit assimilé salarié de l’entreprise (pour une SAS), il ne peut pas prétendre aux allocations chômages en cas de renvoi.
Le CEO est le capitaine du navire. Celui qui donne la direction et s’assure que l’équipage travaille efficacement. Il assume de grosses responsabilités et il est très bien payé pour ça. En cas de succès, ses stock-options peuvent lui rapporter beaucoup mais, en cas de problème, 20 minutes de réunion Zoom du conseil d’administration peuvent suffire à le renvoyer chez lui sans indemnité.
Avis aux amateurs : il faut être adepte des sensations fortes !